La dernière enquête TMO sur la situation de la langue bretonne est sans appel : avec 107000 locuteurs âgés de 58 ans en moyenne, la dernière langue celtique du continent européen est menacée de disparition à court terme. En 1945, la Bretagne comptait plus d’un million de bretonnants, près de 40% de la population bretonne de l’époque.
Ne chom ken nemet 107 000 brezhoneger e 2024 ! 😕 / Il n’y a plus que 107 000 locuteurs en langue bretonne en 2024 (contre 214 000 en 2018)
Pet a vrezhonegerien e 2050 ? / Combien en 2050 ? 🪦 pic.twitter.com/d3gWA31XVf— Brezhoweb (@brezhoweb) January 20, 2025
Les causes de la disparition du breton
Les causes sont connues. En premier lieu, la politique coloniale de l’État français qui, depuis 1789 et la destruction des institutions nationales de la Bretagne, vise à détruire la langue bretonne par une politique méthodique de discrimination linguistique. En 2025, la langue bretonne est toujours interdite d’enseignement dans la plupart des écoles de Bretagne. L’objectif politique de l’État français est l’assimilation culturelle coercitive des Bretons dans l’artificielle nation française au nom d’une idéologie révolutionnaire aux accents millénaristes.
En second lieu, du fait de la colonisation française, l’absence d’une bourgeoisie bretonne parlant la langue bretonne a accéléré l’abandon du breton par les couches populaires qui ont progressivement eu recours au français pour intégrer l’économie française, alors en pleine expansion.
La question de la langue bretonne est inséparable de la question nationale bretonne, ainsi que du rapport des Bretons à un état, l’État français, qui agit en puissance coloniale. Mais elle est également inséparable de la question sociale et économique puisque la langue française n’est pas que la langue administrative d’un état étranger, mais aussi celle d’une colonisation économique étrangère.
Les défenseurs et promoteurs de la langue bretonne ne pouvaient rencontrer aucun succès stratégique sans intégrer la question de la libération nationale bretonne dans leur réflexion et leur action. Prétendre « sauver » la langue bretonne dans le cadre de l’État français contemporain, un état dont l’ADN intègre dès l’origine la destruction de la langue bretonne comme véritable raison d’être en Bretagne, est un contresens historique, politique et pratique. Le combat pour la langue bretonne est inséparable du combat pour la libération nationale de Breizh car c’est ce qu’a décidé l’État français en conditionnant son rapport à la Bretagne à sa destruction nationale, culturelle et linguistique.
L’exemple d’Israël

L’exemple de l’État d’Israël mérite d’être étudié de près, mais également copié méthodiquement dans tout ce qu’il a de reproductible dans le contexte breton. Israël est le produit d’un processus de libération nationale qui articule état et langue modernes dans son projet d’émancipation. La dialectique entre état et langue qui a présidé à la formation d’Israël rejoint celle qu’expérimente Breizh comme nous l’avons cité plus.
L’hébreu est une langue sémitique avec une longue histoire, utilisée principalement comme langue liturgique et littéraire depuis l’Antiquité. Après la destruction du Second Temple en 70 EC, l’hébreu a été largement remplacé par l’araméen et plus tard par des langues comme le yiddish et le ladino parmi les communautés juives dispersées dans le monde.
Avant Ben-Yehuda, il y eut des efforts sporadiques pour revitaliser l’hébreu, notamment par des écrivains et des philosophes comme Maimonide au Moyen Âge. Au XIXe siècle, des figures comme Abraham Mapu écrivaient des romans en hébreu, et des poètes comme Judah Leib Gordon utilisaient l’hébreu dans la poésie. Il est alors une langue morte, comme le latin et comme menace de le devenir le breton aujourd’hui, mais qui est pratiquée par des intellectuels au sein de cercles de passionnés acquis à une idée : produire une culture juive moderne.
Ben-Yehuda, père de l’hébreu moderne
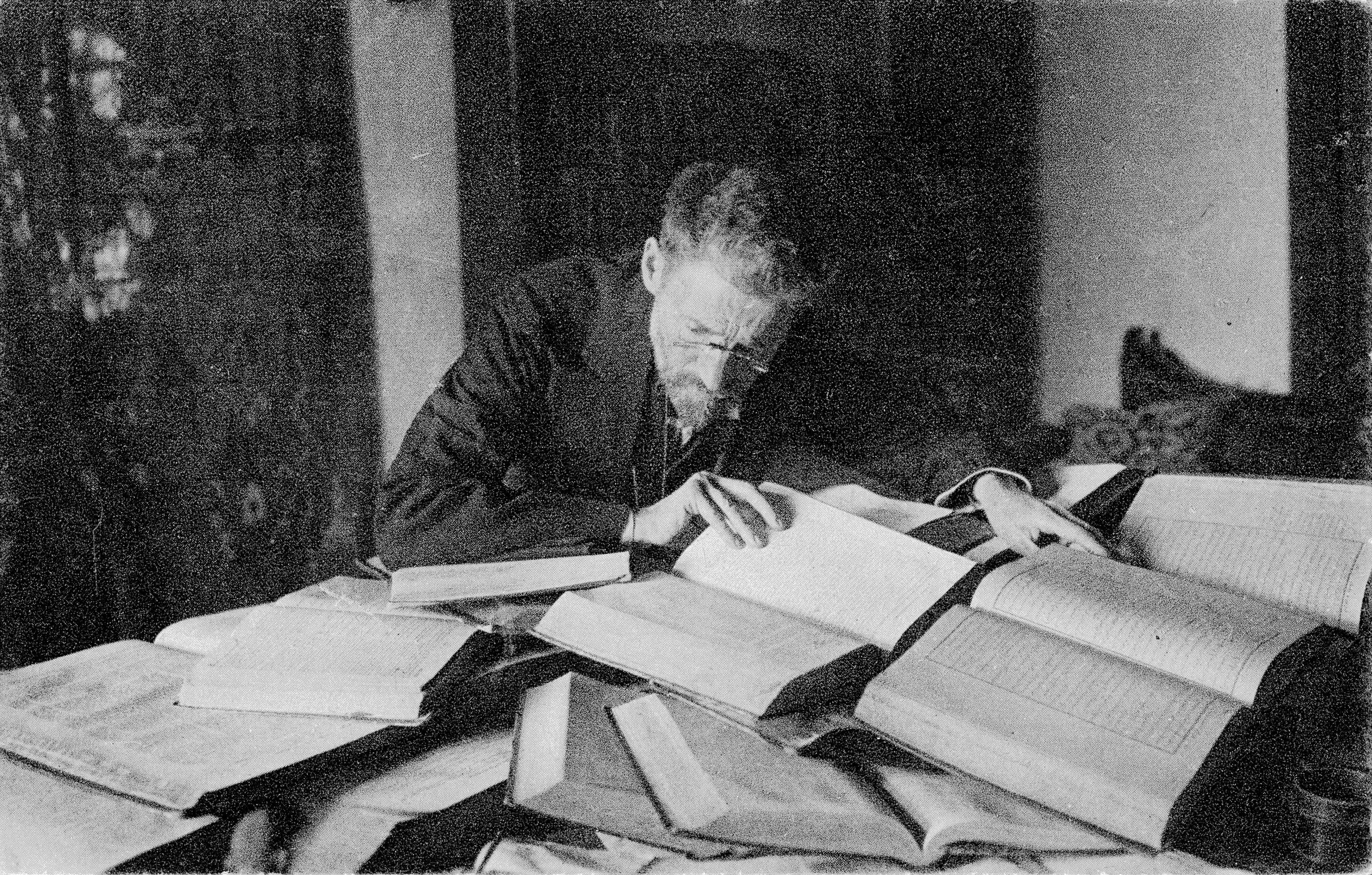
Ben-Yehuda
Né en Lituanie en 1858, Ben-Yehuda émigre en Palestine en 1881 et décide de faire de l’hébreu une langue parlée vivante. Jusqu’à lors, l’hébreu (ancien) était une langue liturgique et la classe des rabbins, très influente dans les communautés archaïques d’Europe de l’Est, était dogmatiquement hostile à son utilisation en dehors des rites religieux. Ben Yehuda rompt avec cet interdit pour produire une pratique profane de l’hébreu modernisé à cet effet. Il commence par éduquer son fils en hébreu moderne, le premier enfant à grandir avec l’hébreu comme langue maternelle depuis des siècles, et lui impose strictement l’usage de cette langue à l’exclusion de toutes les autres. Il publie également le premier dictionnaire moderne de l’hébreu, « The Complete Dictionary of Ancient and Modern Hebrew », dont la publication a commencé en 1908 et s’est poursuivie après sa mort.
Ben-Yehuda, en collaboration avec d’autres linguistes et éducateurs, développe l’hébreu pour les besoins modernes en inventant de nouveaux termes pour la technologie, la science, et la vie quotidienne. Ils s’inspirent largement de racines hébraïques anciennes, mais aussi de l’araméen, du yiddish, et d’autres langues.
Adoption par l’élite nationale israélienne

Première page du journal HaZvi avec un sous-titre indiquant « Journal d’information, de littérature et de science ». HaZvi a révolutionné l’édition de journaux hébraïques à Jérusalem en introduisant les questions séculaires et les techniques du journalisme moderne.
Au début du 20e siècle, Israël n’existe pas encore en tant qu’état. Réunis dans ce qu’ils nomment le « Yishouv » (« peuplement »), les sionistes n’ont pas de conception unifiée de ce que doit devenir l’État juif. Deux langues font figure de candidates : le yiddish, parlé dans le foyer géographique d’où émerge le sionisme, et l’hébreu moderne, encore marginal, mais ardemment défendu par les sionistes les plus ambitieux. D’autres langues, comme l’allemand ou l’anglais, sont également parlées par les migrants juifs venus d’Europe de l’Ouest qui y voient la garantie de l’accès à la modernité pour le futur état juif.
La création de l’Université hébraïque de Jérusalem en 1918, qui utilisait l’hébreu comme langue d’enseignement, et plus tard, le système éducatif israélien, jouèrent un rôle crucial. Des écoles, des journaux comme « Haaretz » (1919), et des événements culturels ont aidé à répandre et à normaliser l’usage de l’hébreu. Avec la déclaration de l’État d’Israël en 1948, l’hébreu est adopté comme langue officielle. Le gouvernement et les institutions publiques commencent à fonctionner en hébreu. La « Loi sur la langue » de 1948 fait de l’hébreu la langue officielle administrative, bien que l’arabe soit également reconnu pour la minorité palestinienne.
Poursuite de la modernisation
Académie de la Langue Hébraïque
Fondée en 1953, l’Académie de la Langue Hébraïque: continue le travail de Ben-Yehuda en régulant la langue, créant de nouveaux mots, et assurant son développement avec l’évolution technologique et scientifique. L’hébreu a dû s’adapter à l’internet, aux technologies de l’information, et à la culture populaire. Cela a inclus la création de termes pour concepts modernes comme « Internet » (אינטרנט) ou « ordinateur » (מחשב).
L’hébreu moderne incarne la synthèse entre la mémoire nationale d’un peuple mobilisé par l’idée nationaliste et son adaptation aux contraintes de la modernité par un état national. À ce titre, l’expérience linguistique israélienne est un exemple historique que l’Emsav doit analyser et copier dans sa philosophie et ses méthodes pour faire du breton la langue de l’État breton moderne.
Proposition d’Adaptation pour une Politique en Faveur du Breton en Bretagne
Le breton est une langue celtique avec une base de locuteurs, mais elle est en déclin face au français dominant. La politique linguistique française, centralisée et monolingue, pose un défi majeur à la renaissance de la langue bretonne. Aucun succès décisif ne peut être acquis sans intégrer la question linguistique dans celle plus large de l’émancipation nationale bretonne dont la langue est l’expression vivante. La lutte linguistique est conditionnée par la lutte politique qui doit libérer la Bretagne d’un état étranger, l’État français, qui, par ses institutions, empêche cette renaissance de notre peuple et de sa langue. L’autonomie de la Bretagne (puis l’indépendance) est donc indispensable à l’adoption d’une stratégie de libération linguistique.
1. Éducation et Formation

L’intégration de la langue bretonne dans le système scolaire est essentielle. Rendre l’apprentissage du breton obligatoire dans les écoles maternelles, primaires et secondaires de Bretagne est un impératif.
Pour cela, la formation des enseignants est cruciale. Il faut une augmentation substantielle du nombre de formations pour les enseignants en langue bretonne, notamment en assurant des bourses et des incitations financières pour ceux qui choisissent cette voie.
La création d’une université et d’une éducation supérieure est une mesure stratégique vitale. En créant une université en langue bretonne, une nouvelle élite brittophone fournira les cadres de la révolution linguistique à tous les échelons de la société en Bretagne.
2. Médias et Culture
La création d’un pôle audiovisuel doit permettre de disposer de médias, notamment télévisuels, exclusivement en langue bretonne qui émettent sur l’ensemble de la Bretagne. La création de contenus attractifs pour les jeunes, comme des séries, films, et émissions de divertissement, doit figurer parmi ses priorités.
Pour la littérature et l’édition, subventionner les éditeurs pour qu’ils publient plus de livres en breton, y compris des traductions d’œuvres populaires.
Grâce à des festivals et événements culturels, promouvoir des rencontres qui mettent en avant la langue bretonne et son usage, comme des festivals de musique, de poésie, de théâtre. Une grande fête annuelle de la langue bretonne devrait être organisée pour tous les brittophones, notamment les plus jeunes, afin d’associer étroitement la Bretagne, son peuple et sa langue.
3. Administration et Services Publics

Rendre obligatoire l’adoption de la langue bretonne dans tous les services publics en Bretagne avec la traduction des documents officiels, des formulaires et des communications.
Assurer que les fonctionnaires soient formés en breton, de préférence dès le recrutement.
4. Politiques Linguistiques
L’adoption de lois qui protègent et encouragent l’usage de la langue bretonne, avec des sanctions prévues en cas de discrimination linguistique.
Offrir des subventions aux familles et aux entreprises qui utilisent le breton au quotidien, par exemple, pour les enseignes commerciales ou la communication interne.
5. Technologies et Innovation
Soutenir financièrement le développement de logiciels et d’applications mobiles en breton, incluant des outils de traduction et de reconnaissance vocale, etc..
Jeux Vidéo : Encourager la traduction ou la création de jeux vidéo en breton pour attirer les jeunes générations.
6. Internationalisation et Coopération
Créer des partenariats avec d’autres pays afin de partager les meilleures pratiques en matière de revitalisation linguistique, notamment le Pays de Galles.
Organiser des échanges culturels et éducatifs avec d’autres communautés linguistiques minoritaires pour renforcer la conscience militante du peuple quant à la préservation de sa langue.
7. Sensibilisation et Promotion
Lancer des campagnes de sensibilisation pour valoriser la langue bretonne, mettant en avant son histoire, sa culture et son importance pour l’identité bretonne.
8. Création de communes bretonnantes
Par un effort méthodique du gouvernement breton, mais avant lui par des initiatives organiques du peuple breton lui-même, organiser l’implantation de communautés brittophones homogènes dans les communes de Bretagne en s’assurant qu’elles bénéficient des infrastructures nécessaires à leur développement (écoles, logement, etc.). Il s’agit là de recréer des communautés qui parlent la langue bretonne dans leur vie quotidienne.
État, langue et nationalisme
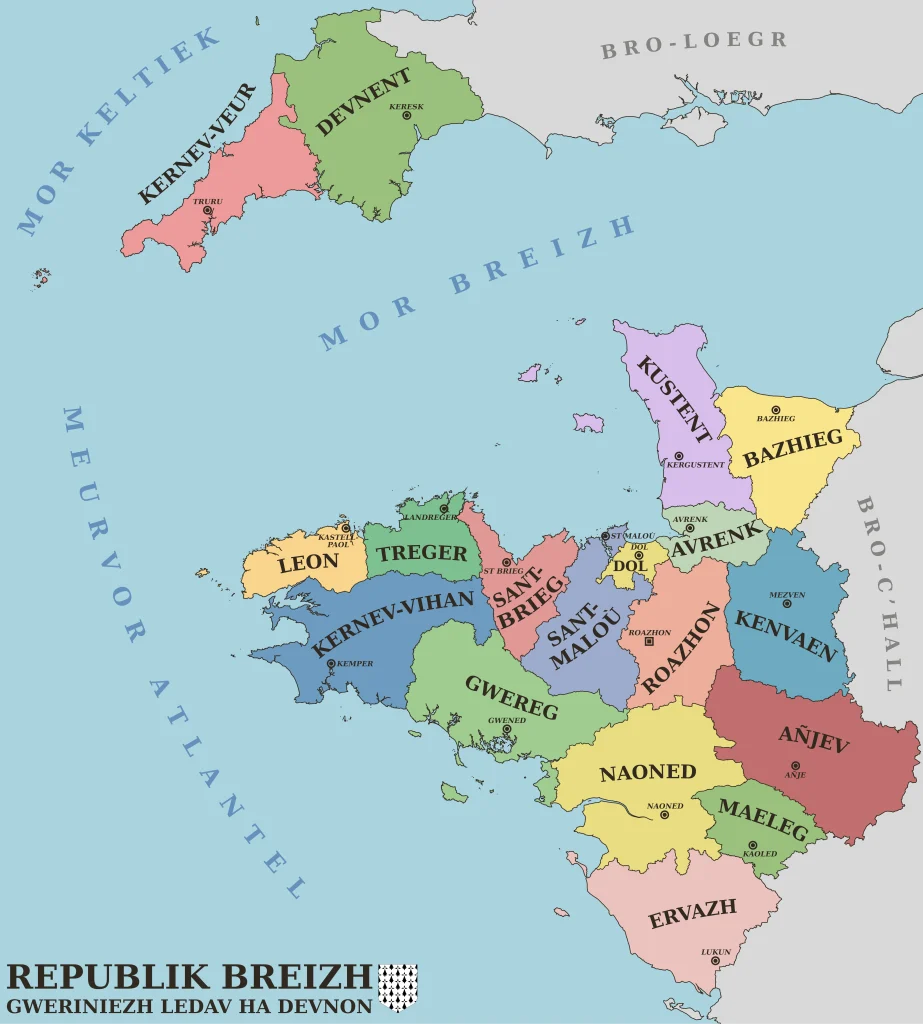
Ces mesures intermédiaires doivent accompagner la révolution politique elle-même qu’est la constitution d’un État breton de langue bretonne. En faisant de la langue bretonne la langue de l’État et de ses institutions, la langue bretonne deviendrait la langue de la verticalité politique et regagnerait son prestige de langue de culture et d’action auprès de la population bretonne, par opposition à sa marginalisation sociale actuelle au sein de la société française qui décourage les Bretons de la maîtriser et de la parler.
Le principal moteur de la langue bretonne n’est autre que la volonté des Bretons de parler la langue de leurs ancêtres. Le développement d’une très forte fierté ethno-nationale chez les Bretons est indissociable de la raison d’être de l’État breton dont l’usage de la langue bretonne serait l’expression concrète. État, langue et nationalisme sont donc intimement liés et doivent être présentés en ces termes par l’Emsav dans son programme et ses orientations politiques.
Ewen Broc’han
Recevez notre newsletter par e-mail !



